Dimanche soir pris la décision, après quelques tergiversations raisonnables (fatigue à un degré tel qu’elle ne se laissait plus ignorer), de passer une nuit blanche : pas assez fort la sensation du sommeil au moment où je m’apprêtais à y aller, et, pour me tenir éveillé (il fallait que je parte tôt de l’appartement pour arriver à l’heure à un workshop de la HEAD à Genève, du moins le croyais-je), lancé Let the summer never come again d’Alexandre Koberidze, dont il m’avait filé un lien il y a quelque temps. Je le lui avais demandé, afin de pouvoir mieux inscrire son Dry Leaf (présenté en compétition à Locarno cette année) dans une recherche artistique au long cours.
Bizarrement ou non, je crois que l’état de relatif abrutissement où je me trouvais (la fatigue), mêlé à une certaine adrénaline (la joie de commencer le workshop) constituait le mélange idéal pour une réceptivité peut-être pas maximale, mais à tout le moins optimale, devant les trois heures vingt-deux qui m’attendaient.


Paysages mélancoliques et desséchés d’un été “sempiternel” – un temps mythologique plus qu’un temps concret – rendu avec force par la pixellisation radicale de l’image (Sony Ericson, utilisé également pour Dry Leaf), par le lancinement d’une musique à demi symphonique, à demi atonale, laquelle impose les déséquilibres de son rythme brisé : composition du frère du cinéaste, Giorgi Koberidze, qui s’emporte dans des élans Hollywood classiques avant de se stopper tout net, au seuil du bruit (vacarme urbain, explosion), à l’orée des éléments (le vent, le vent qu’on entend si bien, dans son grondement mal dépoli). Bruissement numérique qui transforme un hall de gare en paysage à la Turner (le zoom de plus en plus rapproché sur le mur), une répétition de danse traditionnelle en tableau de Seurat. Colline en haut d’un bois qui s’engouffre dans une soudaine obscurité à la faveur d’un recadrage, devenant une masse sombre et mystérieuse, là, dans le soleil de l’été.
Voix off qui anticipe régulièrement les tours et détours du scénario – du destin du protagoniste – pour précisément déjouer le déroulé du scénario, d’une narration qui s’imposerait d’elle-même : laisser la place, toute la place, la première place, à ce qui ne serait (ailleurs, dans d’autres mondes de fiction et de cinéma) que résidu, qu’interstitiel : scènes de vie dans la ville, gens dans le bus, étreintes de couples, natures mortes dans la cuisine, fontaines, chiens errants faisant la sieste à même la rue, arbres, vues bucoliques. Tout fait signe vers l’issue d’une histoire d’amour inattendue, impensée ; une histoire d’été vouée à s’échouer sur le ressac d’une mémoire plus ample, quelque part inhumaine. C’est ce hiatus entre l’insignifiance de l’intime et le vertige de la rémanence (de l’histoire, du mythe) qui donne son mouvement au film.
En vitesse je me rase, je me douche, je prépare le café dans la cafetière italienne une tasse, je trace vers la gare. Un peu avant huit heures, route des Franchises, la montagne à l’horizon est ce matin engloutie par les nuages. Je me retourne : le soleil maintenant levé dore de ses rayons encore un peu endormis le glacis des immeubles modernes, rasant leur surface sans pouvoir s’y fixer. Toute la journée j’ai l’impression de flotter sur un nuage, un nuage de macroblocks comme dans un plan de Sandro Koberidze.


Le soir, alors que je me lève pour quitter la salle après le film, mes yeux rencontrent l’iris du projecteur, luminescente pour quelques instants encore de générique de fin.
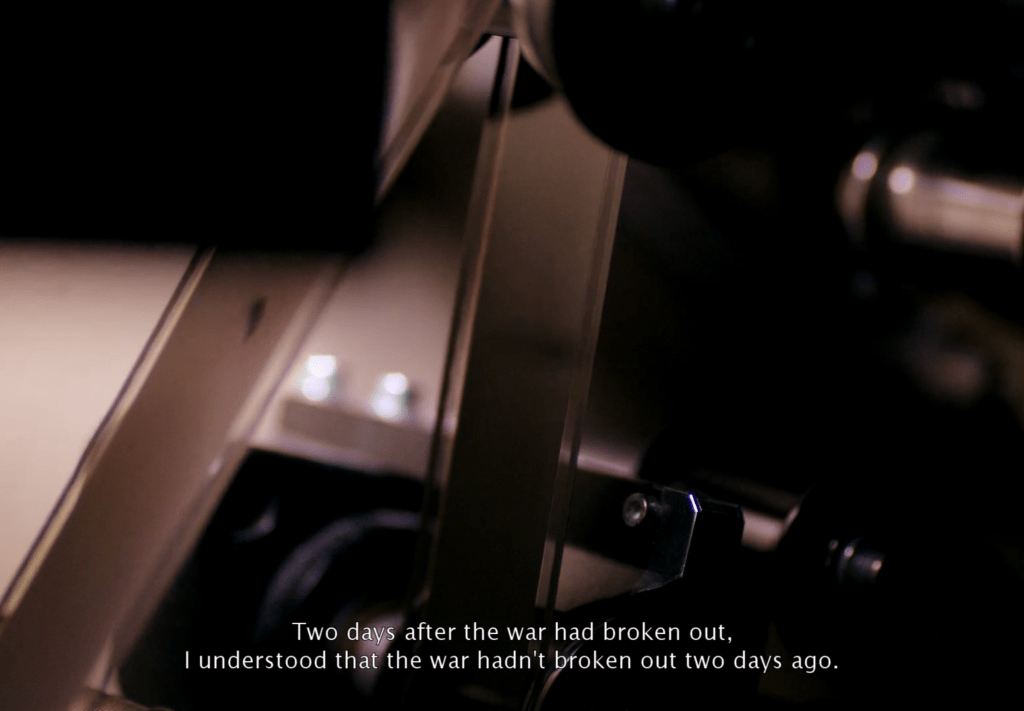
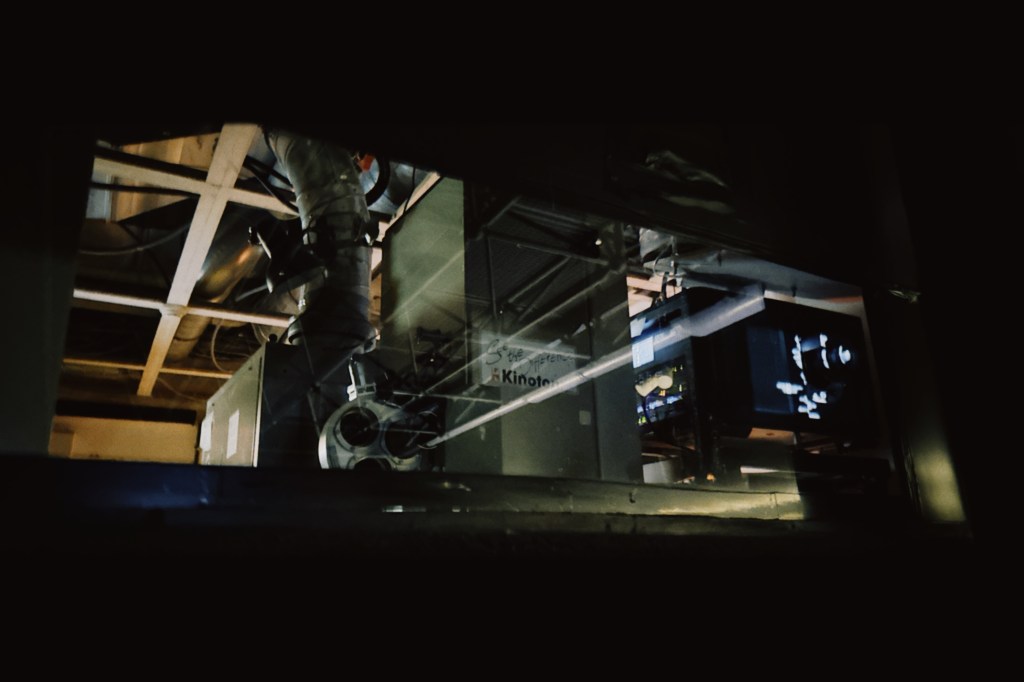
Laisser un commentaire